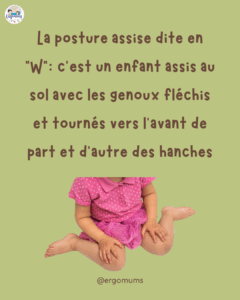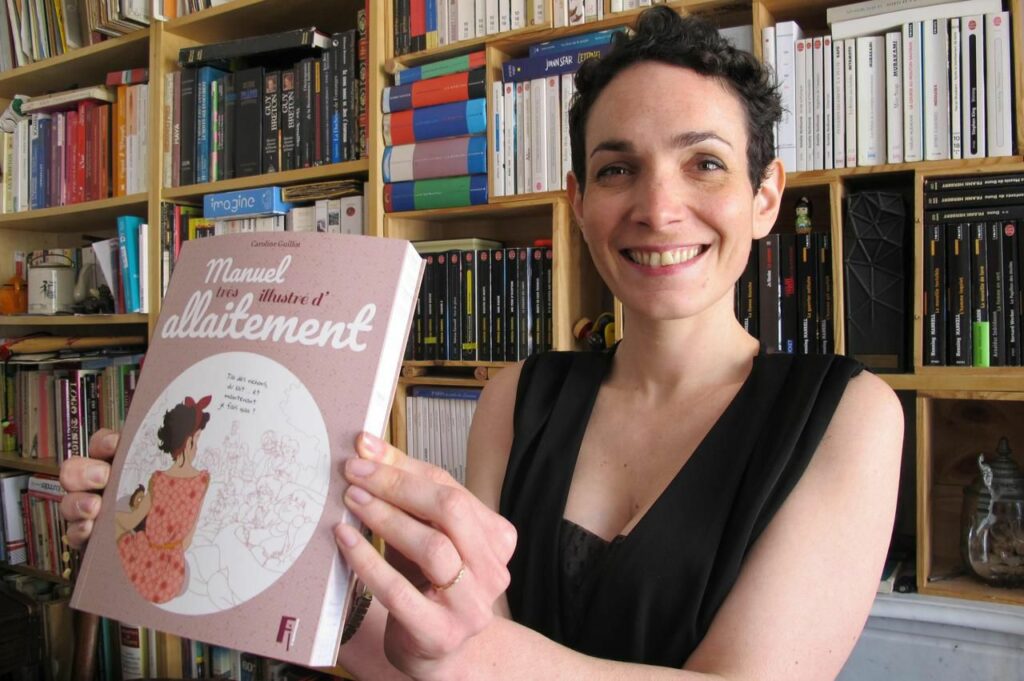Entre peur de l’échec et besoin de contrôle
Au détour d’une conversation entre adultes, où l’on évoquait nos éducations, est venu sur le tapis le fait de laisser la possibilité de choisir et de décider. Par exemple pouvoir décider de sa coupe de cheveux, de ses habits, de comment il peut s’habiller. Tout en accompagnant parfois avec des choix dirigés. Alors attends, je te vois venir: il s’agit bien de laisser décider son enfant à hauteur de son âge, dans un cadre sécurisé…
Dans la conversation, une question s’est alors posée « Est-ce-que la façon dont on nous a laissé choisir, nous tromper, a pu impacter l’adulte qu’on est aujourd’hui et notre capacité à prendre des décisions et accepter de se tromper?
Et si cette peur de se tromper prenait racine plus tôt? Si on pouvait trouver la réponse dans l’avancée des neurosciences actuelles? Est ce que notre éducation a pu faire des association entre « faire une erreur » qui va entrainer danger, humiliation ou punition.
🧠 Le cerveau de l’enfant : immature, plastique et hautement relationnel
On sait maintenant que le cerveau de l’enfant est en plein développement et cela pendant longtemps. De façon neurodéveloppemental, il est :
• Dominé par le cerveau limbique, c’est la partie responsable notamment des émotions (agréables ou désagréables), de la mémorisation et des circuits de la récompense. Le système limbique est lui-même régulé au fur et à mesure par le néocortex, afin que les émotions ne soient pas envahissantes. Mais ce cerveau émotionnel va rester dominant chez l’enfant jusqu’à 5-6 ans.
• Peu gouverné par le cortex préfrontal, ce dernier est responsable des fonctions cognitives dites supérieures : (conscience, langage, capacités d’apprentissage, perceptions sensorielles, commandes motrices volontaires, représentation dans l’espace, prise de décision et jugement adaptatif), ainsi que de la régulation du cerveau archaïque, et du cerveau émotionnel. Le néocortex permet la maîtrise de soi et sera mature vers l’âge de 25 ans en moyenne. Du fait de son moindre contrôle frontal, l’enfant vit donc les émotions beaucoup plus intensément que l’adulte.
Apprendre la maitrise de soi, est extrêmement sensible à la relation avec l’adulte : c’est cette relation – et notamment la manière dont l’adulte accueille les émotions, les erreurs, les frustrations ou les conflits – qui sculpte littéralement le cerveau de l’enfant.
Les travaux de Stanislas Dehaene, Catherine Gueguen ou Boris Cyrulnik montrent que l’enfant n’apprend pas par la contrainte ni la menace, mais par l’exploration libre, la sécurité affective et un feedback bienveillant.
🚨 L’effet de la punition sur le cerveau
 Quand un enfant se trompe ou fait une erreur (aux yeux d’adulte): par exemple quand il renverse un verre et que la réponse de l’adulte est la suivante: « t’es nul », « fais attention », « tu m’énerves », cela active son système d’alerte neurologique émotionnelle.
Quand un enfant se trompe ou fait une erreur (aux yeux d’adulte): par exemple quand il renverse un verre et que la réponse de l’adulte est la suivante: « t’es nul », « fais attention », « tu m’énerves », cela active son système d’alerte neurologique émotionnelle.
Les conséquences immédiates sur le cerveau :
• Activation de l’amygdale (cerveau émotionnel) → stress émotionnel intense. Elle est capable de générer une réponse physiologique à un danger avant même que celui-ci ne soit perçu consciemment. La peur se fraye plusieurs chemins dans le cerveau, mais tous passent par l’amygdale.
• Inhibition de la mémoire de travail: La mémoire de travail, un système cérébral qui assure le stockage temporaire et la manipulation des informations nécessaires à des tâches cognitives complexes telles que la compréhension du langage, l’apprentissage et le raisonnement.
• Désactivation du cortex préfrontal (impossible de raisonner ou d’ajuster): C’est la partie du cerveau qui se développe, à la fin de l’adolescence. Grâce à ses nombreuses connexions avec d’autres zones corticales, le cortex préfrontal est impliqué dans de nombreux processus cognitifs d’ordre supérieur, tels que la prise de décision, le raisonnement, l’expression de la personnalité et la cognition sociale.
• Baisse de la plasticité cérébrale (le cerveau n’apprend plus bien): tout au long de la vie, au gré de nos activités et de nos expériences, notre cerveau évolue et forme de nouvelles connexions.
📚 Le Harvard Center on the Developing Child (2021) montre que le stress chronique altère les circuits du cortex préfrontal, essentiels pour la prise de décision, la régulation émotionnelle et la flexibilité cognitive.
Des IRM (Cuartas et al., 2020) révèlent également que les enfants régulièrement punis présentent une altération du cortex préfrontal et du cortex cingulaire antérieur, deux zones clés pour la régulation, le raisonnement et l’ajustement post-erreur.
🌱 L’erreur : un levier puissant de construction neuronale
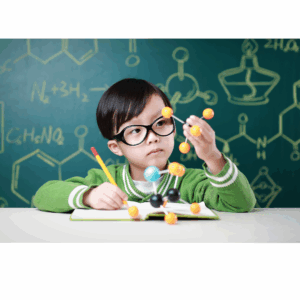 Et si, au lieu de chercher à éviter l’erreur, on en faisait une alliée d’apprentissage ?
Et si, au lieu de chercher à éviter l’erreur, on en faisait une alliée d’apprentissage ?
Le cerveau apprend mieux lorsqu’il se trompe, à condition d’être dans un environnement sécurisant.
• Effet d’hypercorrection : corriger une erreur que l’on pensait juste crée une mémorisation plus durable (Dehaene, 2020)
• Le cortex cingulaire antérieur détecte l’erreur et mobilise le cortex préfrontal pour chercher une solution
• Mais si l’enfant est jugé ou stressé, ce système se fige : il apprend seulement à éviter l’erreur, pas à la comprendre
🛠️ Comment éduquer en respectant le développement neurocognitif de l’enfant ?
On s’éloigne ici des modèles éducatifs autoritaires ou autoritatifs, pour se rapprocher des approches fondées sur les neurosciences affectives. On va donc mettre en avant :
• Une Co-construction les règles, selon l’âge et les capacités de l’enfant. Et on va être attentif que l’enfant soit en capacité de les comprendre et retenir. Les pictogrammes sont un moyen visuel de mettre en place des règles qui seront plus compréhensible par l’enfant et donc reproductible (Contrairement aux consignes verbales)
• Favorisent l’expérimentation guidée : « Tu veux essayer ? On teste, on regarde ensemble le résultat et on voit ce qui a fonctionné et ce qui est possible d’améliorer.
• Acceptent que l’enfant échoue, se trompe et réajuste, comme une étape normale de son développement
🔁 En ergothérapie, il existe une approche en rééducation qui s’appelle CO-OP. L’approche CO-OP est une approche d’intervention initialement développée pour les enfants atteints de troubles de la coordination (TCD), mais elle a également démontré son efficacité auprès d’autres populations, telles les enfants ayant une déficience motrice cérébrale, les enfants et adultes ayant eu un traumatisme crânien ou les adultes ayant subi une lésion cérébrale. L’approche est centrée sur l’utilisation de stratégies cognitives afin d’améliorer les compétences du client dans les activités qu’il préfère, ou doit faire, mais qu’il réalise difficilement.
Cette approche d’intervention se distingue de certaines approches traditionnelles utilisées en réadaptation parce que le rôle du thérapeute est de guider le client dans la découverte de stratégies cognitives qui lui permettront d’apprendre, ou de réapprendre, à fonctionner de son plan, de ses échecs afin de réorganiser son plan, afin d’arriver à une réussite, c’est à dire une performance qui lui convient.
💬 Transformer nos phrases du quotidien
Parfois, quand un enfant fait une erreur, certains termes peuvent être très dur et rabaissant: ❌ « T’es nul, fais attention, t’es tellement maladroit, tu le fais exprés…»
Il est important de changer notre vocabulaire, afin de ne pas figer l’enfant dans son échec mais plutôt de l’accompagner vers une nouvelle exploration afin d’accéder à la réussite. On peut donc dire à la place: ✅ « Ah, tu en a mis à coté en remplissant ton verre. On va nettoyer ensemble. Tu crois que la bouteille était trop lourde, trop pleine ou alors est ce que le verre a bougé ? Que peut-on faire différemment la prochaine fois ? »
Ce changement de posture et d’attitude de l’adulte, stimule les bonnes zones cérébrales :
Plasticité neuronale: elle va activé les essais-erreurs qui sont possibles quand il n’y a pas de peur de l’échec
Cortex préfrontal: afin de pouvoir choisir, planifier et évaluer
Cortex cingulaire antérieur: il va permettre de savoir détecté les erreur et ensuite d’ajuster le comportement.
Système limbique apaisé: c’est la présence d’une personne sécurisante et compréhensive qui va le permettre
🚫 Bienveillance ≠ laxisme
L’éducation bienveillante n’est ni permissive, ni paternaliste, ni punitivement rigide.
Elle repose sur trois piliers essentiels :
1. Un cadre clair et constant, adapté à l’âge de l’enfant (ex : pictogrammes plutôt que phrases longues pour les jeunes enfants)
2. Une relation affective stable et sécurisante (ex : accueillir les émotions, cela veut dire les comprendre sans les balayer, les minimiser ou encre les nier, mais cela ne veut pas dire céder à la demande.
3. Un accompagnement dans l’erreur (ex : laisser l’enfant faire, se tromper, ajuster son geste ou son raisonnement)
👣 L’apprentissage passe par l’action et l’erreur motrice
 Lorsqu’un enfant apprend à couper sa viande, à enfiler un vêtement ou à s’habiller seul, il va se tromper. Il ajuste ses gestes grâce à un feedback sensoriel, qui envoie des signaux correcteurs au cerveau.
Lorsqu’un enfant apprend à couper sa viande, à enfiler un vêtement ou à s’habiller seul, il va se tromper. Il ajuste ses gestes grâce à un feedback sensoriel, qui envoie des signaux correcteurs au cerveau.
👉 Plus l’enfant répète librement dans un environnement soutenant, plus il crée des connexions robustes et efficaces.
Ce processus est observable dès les tout-petits : ils font, refont, ajustent, testent. Le cerveau est une machine à apprendre par essai-erreur, pas par anticipation parfaite.
🧩 Sens, confiance et autonomie
Une éducation fondée sur le sens et non sur la peur permet à l’enfant de :
• Comprendre pourquoi une règle existe (ex : “on roule lentement en voiture pour éviter les accidents mortels”)
• Prendre des décisions adaptées à son âge et à sa maturité cérébrale
• Apprivoiser ses émotions et ne plus en être prisonnier
• Oser se tromper, ajuster, recommencer
Un enfant figé qui « obéit aux doigts et à l’oeil », « qui ne fait jamais d’erreur », n’est pas “sage” : Un enfant qui est apeuré va être dans la résilience et donc faire les choses (c’est le même mécanisme quand on est frappé ou en danger, on peut faire des choses pour se soustraire à une situation dangereuse ou extreme tension. L’enfant peut être apeuré, bridé, inhibé et donc suivre à la lettre les choses et éviter de prendre des initiatives.
Ce qu’on veut développer, c’est la confiance, la capacité à décider, à réparer, à oser.
🎯 Conclusion : enseigner à se tromper, pas à éviter l’échec
« Décider, c’est accepter l’incertitude. Cela s’apprend dans un environnement où l’enfant peut expérimenter sans risque d’être brisé. » — Dr Catherine Gueguen
Pour que l’adulte de demain puisse décider, s’affirmer et rebondir, il faut que l’enfant d’aujourd’hui ait eu le droit de se tromper. L’objectif : ne pas juger l’erreur, mais l’analyser. L’aider à comprendre pourquoi « ça n’a pas marché », pour qu’il puisse créer un nouveau plan, plus ajusté, plus conscient.
🔎 Et toi, adulte :
Est-ce que tu as grandi dans un environnement où tu avais le droit de te tromper ?
Ou bien ressens-tu encore, aujourd’hui, cette peur de mal faire, ce besoin d’être validé ?
📚 Références clés
• Dehaene, S. (2020). Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines Niveau de preuve B
• Harvard Center on the Developing Child (2021). Stress and the developing brain. Niveau de preuve A
• Cuartas et al. (2020). Corporal punishment and child development. Niveau de preuve A
• Gueguen, C. (2014). Pour une enfance heureuse Niveau de preuve C
• Cyrulnik, B. (2017). Psychologie de la résilience. Niveau de preuve C
• Van Duijvenvoorde et al. (2008). Neural correlates of feedback-based learning in children and adolescents (J. Neurosci.). Niveau de preuve A
Les niveaux de preuves
A Haute qualité scientifique : méta-analyses, revues systématiques, essais contrôlés randomisés, études IRMf publiées en revues à comité de lecture. Données reproductibles, fiables, rigoureuses
B Études bien menées mais non randomisées, ou ouvrages de synthèse sérieuse, articles scientifiques en cours de validation. Moins généralisables que le niveau A
C Ouvrages de vulgarisation, essais cliniques non publiés, expérience clinique, consensus d’experts. Utiles en pratique, mais subjectifs
D Opinion d’expert isolé, narrations personnelles, témoignages, documents non vérifiés scientifiquement. Doit être utilisé avec précaution